Actualités

Droit des Affaires
Pas de droit de préemption pour le locataire commercial en cas de vente des biens du bailleur dans le cadre d’une liquidation judiciaire
Écrit par Céline HumbertFocus sur l’arrêt rendu le 15 février 2023 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, (pourvoi n° 21-16.475).
Le locataire d’un bail commercial jouit depuis la réforme Pinel d’un droit de préemption lorsque le bailleur vend le local loué, dans les conditions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
Toutefois, le Cour de cassation vient rappeler que cet article ne vise que les ventes volontaires, à l’exclusion des ventes judiciaires. Ainsi, le locataire n’a aucun droit particulier en cas de vente du local « faite d’autorité de justice ». Tel est le cas par exemple en cas de vente consécutive à une saisie immobilière (CA Bastia, 20 janvier 2016, n° 15/00833), en cas de vente sur adjudication intervenue dans le cadre d’une liquidation amiable (Cass. 3ème civ., 17 mai 2018, n° 17-16.113), ou, comme c’est le cas dans notre actualité, en cas de vente de gré à gré autorisée par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du bailleur.
La décision est logique dans la mesure où le bailleur n’a pas la main sur les conditions de la vente à proposer à son locataire. Toutefois, notre arrêt marque les limites pratiques de cette restriction, dans la mesure où le locataire avait en l’espèce formulée une offre à un meilleur prix. Ainsi, il n’est pas certain que l’intérêt des créanciers, ni celui du dirigeant qui a pu se porter caution personnelle de certaines dettes (et vous savez combien ce sujet me tient à cœur...), aient été préservé. Un vide juridique à combler ? On pourrait imaginer que, sans allonger les délais de procédure dans ces situations complexes et urgentes qui nécessitent l’intervention de la justice, une place préférentielle soit aménagée au profit du locataire désireux de formuler une meilleure offre que celle retenue.
La résolution judiciaire du contrat : il n’est pas nécessaire de prouver la faute du débiteur.
Écrit par Céline HumbertEncore minoritaires, les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016 (donc soumis au droit nouveau) sont peu commentés par la jurisprudence.
L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 18 janvier 2023 (n°21-16812) est apporte des précisions sur le nouveau régime de la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, un contrat de prestations de services en vue d’un événement déterminé avait été conclu entre une société exploitant un établissement d’hôtel-restaurant et une société prestataire. L’évènement prévu dans le contrat a été reporté puis annulé en raison de la crise sanitaire. La société prestataire a cependant, malgré mise en demeure de la société d’hôtellerie-restauration, refusé de restituer l’acompte versé au titre du contrat au motif que le contrat n’était pas résilié.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de résolution du contrat de prestations de services de la société hôtelière car le prestataire de service n’avait commis aucune faute.
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel en précisant que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
Pour fonder sa demande la Cour invoque plusieurs articles du code civil :
- l’article 1217 du code civil sur l’inexécution contractuelle ;
- l’article 1227 sur la résolution judiciaire ;
- et l’article 1229 prévoyant la résolution comme cause de fin du contrat du code civil.
Cet arrêt précise les conditions d’application de l’article 1227 du code civil, en affirmant que la démonstration d’une faute du débiteur n’est pas obligatoire pour solliciter la résolution judiciaire du contrat.
En effet, selon la Haute juridiction, il suffira pour la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, de justifier de l’inexécution suffisamment grave de son cocontractant pour obtenir la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la résiliation permet la restitution de l’acompte versé en vue de l’exécution de la prestation.
Il sera intéressant de savoir si ce raisonnement sera confirmé par la chambre civile de la Cour de cassation. La suite au prochain épisode.
Qui est une caution « avertie » ? Les contours de l’obligation de mise en garde de la banque
Écrit par Céline HumbertFocus sur l’arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, X contre Société Banque CIC Nord-Ouest (pourvoi n° 15-20.177) publié au Bulletin.
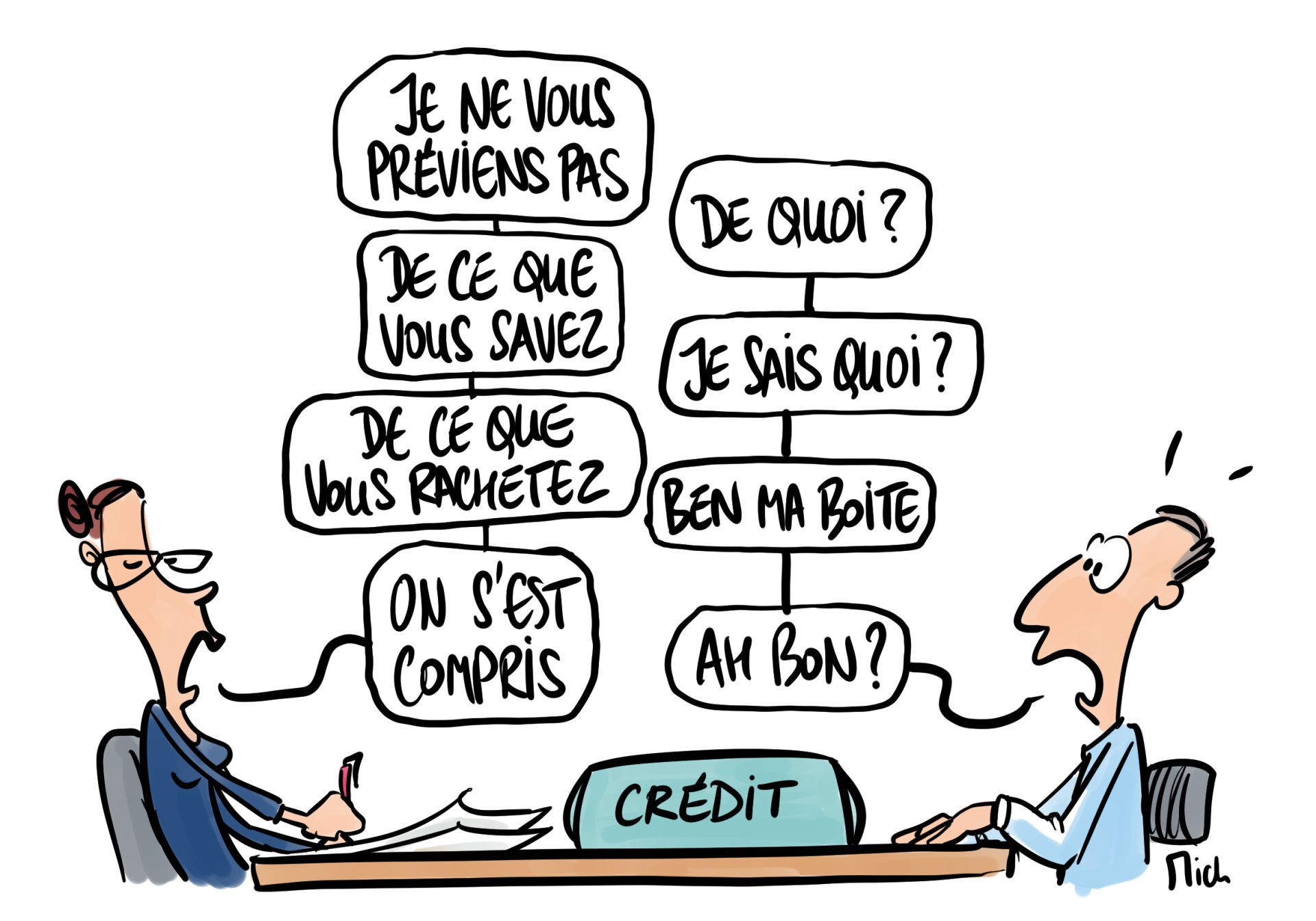
Si la banque est soumise à un devoir de mise en garde envers l’emprunteur et la caution non avertis lors de la conclusion d’un contrat de prêt, cette obligation disparaît lorsque la banque contracte avec un emprunteur dit « averti ».
Mais qui est « averti » ?
Au cas d’espèce, afin d’acquérir l’intégralité des parts de la SARL dans laquelle ils exerçaient, quatre salariés ont constitué une société holding. Pour les besoins de cette acquisition, la holding a contracté un prêt avec le CIC, garanti par le cautionnement d’un des anciens salariés devenu gérant de la holding. Par la suite la holding a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La banque a alors naturellement recherché la caution en paiement.
La caution, également dirigeante de la holding de reprise, conteste la décision rendue par la cour d’appel de Rouen la condamnant au remboursement du prêt, soutenant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde.
Pour rejeter le pourvoi la Haute juridiction retient la caractère « averti » de la caution.
En effet, l’emprunteur avait, durant ses cinq ans d’exercice au sein de la SARL en tant que responsable commercial, doublé le chiffre d'affaires de cette dernière « par la mise en place d’une réelle stratégie commerciale et en lui insufflant un nouvel élan. ». En outre, le montage juridique effectué en vue de l’acquisition de la SARL plaidait également en faveur du caractère « averti » de la caution. Attention cependant car la qualité d’emprunteur averti s’apprécie au jour de la signature du contrat de prêt et ne saurait se déduire de la seule qualité de dirigeant ou associé de la société emprunteuse, puisqu’une expérience de la vie des affaires ou une implication dans la gestion de la société emprunteuse demeure requis par la jurisprudence.
Ainsi, les juges ont considéré que la caution était à même de mesurer le risque d’endettement né de l’octroi du prêt souscrit afin d’acquérir la SARL, dont il connaissait forcément les résultats.
Par conséquent, la Cour précise ici un peu plus les critères caractérisant la qualité d’emprunteur averti qui fait débat de puis maintenant de nombreuses années, tout en rappelant que la qualité d’emprunteur averti d’une personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal au moment de la conclusion du contrat.
INVITATION WORKSHOP 7 DECEMBRE "Caution personnelle du Dirigeant"
Écrit par Céline HumbertNous avons le plaisir de vous inviter à notre workshop sur la caution personnelle du dirigeant, organisé par #60000rebonds et animé par Céline HUMBERT et Jean-Pierre MELANI.
Vous pouvez adresser vos demandes d'inscription à l'adresse: https://my.weezevent.com/atelier-caution-personnelle
Au plaisir de vous y rencontrer !

Violation d’une clause d’intuitu personae et agent commercial.
Écrit par Me Valentine Wirig
Crédit dessin: Michel Szlazak
La Cour de cassation, chambre commerciale le 29 juin 2022 n°20-11.952 et 20-13.228 a jugé que les agents commerciaux s’abstenant d’informer leur mandant d’un changement de direction ou d’actionnariat manquent à leur obligation de loyauté. Ce faisant ils commettent une faute grave justifiant la résiliation du contrat sans indemnité.
Rappelons que l’article L134-12 du Code de commerce prévoit que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ». Cette indemnité n’est écartée que dans les cas limitativement énumérés par l’article L134-13 parmi lesquels figure la faute grave de l’agent commercial. On peut citer à titre d’exemple l’exercice d’une activité parallèle de l’agent même en l’absence de clause d’exclusivité, le désintérêt pour la vente des produits du mandant qui constituent des cas de faute grave.
Dans ces deux arrêts, une clause contractuelle avait été stipulée dans les contrats et prévoyait un agrément par le mandant en cas de changement de direction ou d’actionnariat. Le mandant ayant été informé tardivement voire pas du tout pour le premier arrêt, les contrats furent résiliés pour faute grave.
La Cour de cassation interrogée sur la validité de telle clause dans le contrat d’agent commercial, contourne la question et préfère invoquer le manquement à l’obligation de loyauté pour caractériser la faute grave. L’agent doit donc être loyal à son mandant clause d’intuitu personae ou non.
La Cour de cassation par le raisonnement adoptée confère ainsi une pleine efficacité aux clauses d’intuitu personae et d’agrément, en privant l’agent commercial de son indemnité de fin de contrat en cas de violation.
Cependant ce stratagème permet à la Cour de cassation de maintenir un flou juridique quant à la possibilité de contractualiser la faute grave. Les dispositions de l’article L134-12 étant d’ordre public, il n’est pas possible de les écarter mais peut-on qualifier contractuellement tel ou tel comportement de faute grave ? Rien n’est moins sûr. La Cour de cassation considère que c’est le manquement à l’obligation de loyauté qui constitue une faute grave, et pas la violation directement desdites clauses. C’est parce que l’agent commercial n’a pas informé son mandant de son changement d’actionnariat, qu’il a manqué à son obligation de loyauté. Ce manquement constituant une faute grave justifiant la perte de son indemnité de fin de contrat.
Le praticien devra donc être prudent s’il décide par avance de définir contractuellement la faute grave. L’agent commercial, lui, devra garder à l’esprit qu’il est débiteur d’une obligation de loyauté envers son mandant, et que tous les changements importants de sa situation devront être communiqués à son mandant.
Après la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats spéciaux font l’objet d’un avant-projet de réforme dont les contours ont été communiqués en avril et en mai 2022.
Écrit par Me Laurène Astruc-Cohen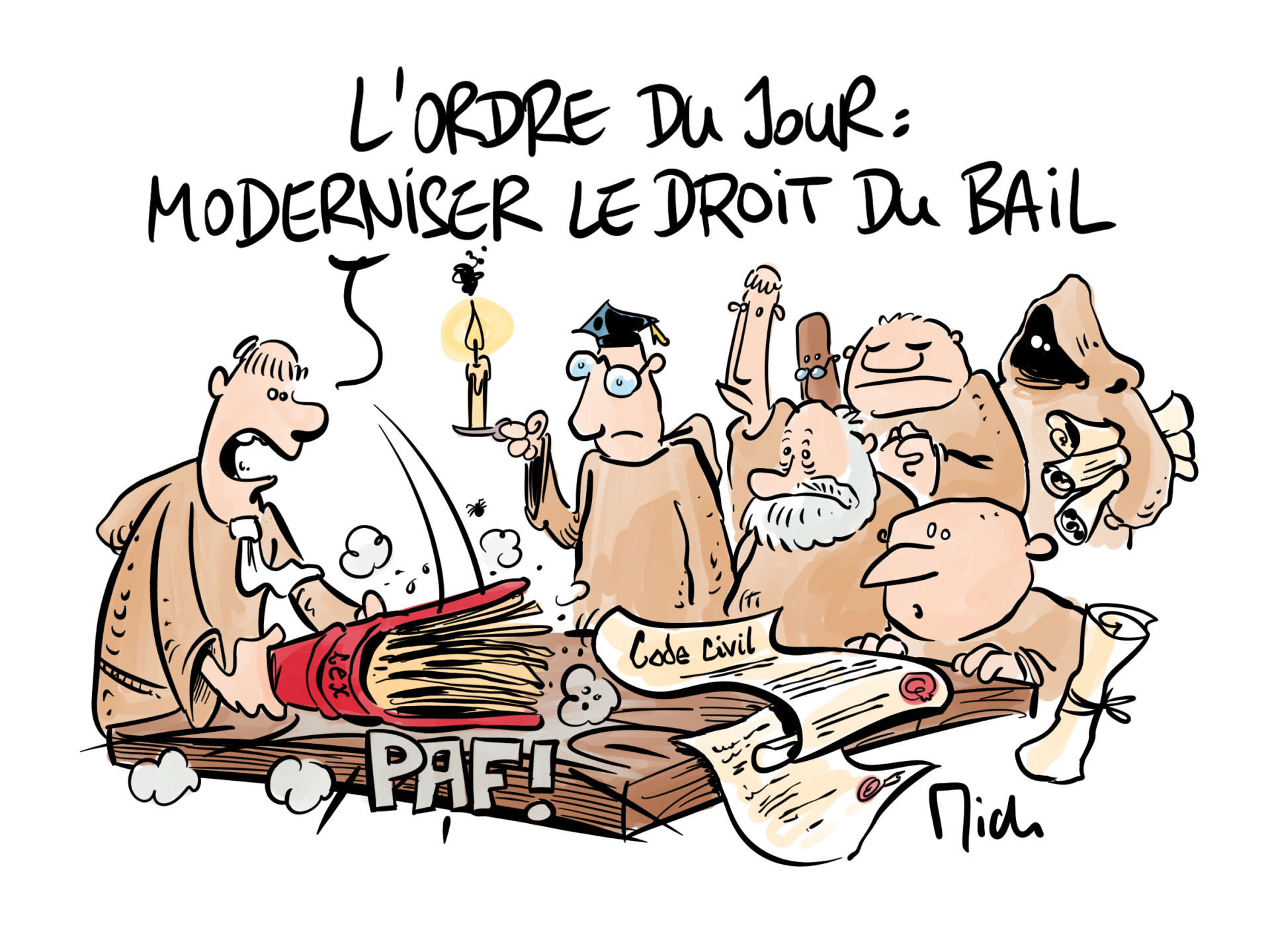
Crédit dessin: Michel Szlazak
L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux a été élaboré par une Commission de huit membres regroupant avocat, professeurs et un conseiller Doyen de la troisième chambre civile de la Cour de cassation avec l’aide de magistrats.
La volonté de clarifier, de simplifier et de moderniser les règles relatives aux contrats spéciaux ont été les moteurs de cette réforme.
Les rédacteurs de l’avant-projet ont souhaité travailler sur plusieurs axes afin de réformer les contrats spéciaux.
Ainsi, l’accent a été porté sur la liberté contractuelle, le souci de construire le droit « à partir de phénomènes du réel, d’avancer du concret vers l’abstrait plutôt que l’inverse », sur la praticité.
Enfin, la commission a indiqué avoir cherché faire œuvre de sagesse dans la rédaction de l’avant-projet.
Par conséquent, chaque projet de contrat a été préparé par plusieurs personnes et a pu faire l’objet d’un vote lorsque des débats émergeaient.
En juillet 2022, l’ensemble de l’avant-projet sera présenté article par article.
Pour lors, l’avant-projet a été présenté s’agissant du contrat de vente, de bail, de prêt, de dépôt et du contrat d’entreprise.
Notre examen va se concentrer sur l’avant-projet de réforme du contrat de bail.
En effet, les règles et les distinctions relatives aux contrats de louage sont particulières vieillissantes. Le code civil distingue aujourd’hui les « baux à loyer », des « baux à ferme », du « bail à cheptel » etc.
Certains des articles actuels n’ont vocation à s’appliquer que de manière résiduelle.
Les articles 1713 et 1714 du Code civil rappellent le principe de consensualisme du contrat de location ainsi que l’exigence d’un loyer.
L’objet du contrat de location pourrait désormais être largement étendu. En effet, l’article 1712 du Code civil modifié par la réforme disposerait :
« On peut louer toutes sortes de choses qui sont dans le commerce, mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, sous réserve des dispositions particulières s’y appliquant.
Lorsque la location porte sur une chose incorporelle, et que les parties ont manqué à y adapter les modalités d’exécution du contrat, notamment quant à la délivrance, l’usage et la restitution, les règles du présent titre s’appliquent autant qu’elles sont compatibles avec la nature de la chose louée ».
La section 2 « Des effets de la location » prévue par l’avant-projet de réforme est divisée en trois sous-sections comprenant les obligations du bailleur, les obligations du locataire ainsi que des règles relatives à la cession de contrat, sous-location et cession de la chose.
L’article 1719 du Code civil prévu par l’avant-projet de réforme précise que : « le bailleur est tenu d’exprimer clairement ce qui se rapporte aux qualités et aux caractéristiques de la chose qu’il loue. Dans cette mesure, les obscurités et ambiguïtés du contrat s’interprètent contre lui ».
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 1722 du Code civil dispose « L’état du bien loué est dressé contradictoirement et par écrit. A défaut, le bien est présumé avoir été délivré en bon état apparent ».
L’obligation d’établir l’état des lieux est désormais textuellement prévu au sein du Code tout comme la description de l’objet du bail afin de clarifier les relations entre bailleur et locataire.
L’entretien de l’objet loué est textuellement prévu par l’article 1730 du Code civil qui dispose « Le locataire est tenu, dans les conditions ci-après :
1° De payer le loyer ;
2° D’entretenir la chose et ne pas en jouir autrement que de raison ;
3° De restituer la chose en fin de contrat.
S’il manque à prendre possession de la chose louée dans un délai raisonnable, le bailleur peut, après mise en demeure, résilier unilatéralement le bail. Le tout sauf clause contraire. »
La sous-section trois ayant trait à la cession du contrat, à la sous-location et à la cession de la chose n’a pas fait l’objet d’un consensus par les membres de la commission de sorte qu’il subsiste une option concernant l’article 1737 du Code civil.
En effet, la proposition majoritaire prévoit que : « Le bailleur dispose d’une action directe en paiement contre le sous-locataire, dans la double limite des loyers et sous-loyers dus.
La sous-location convenue en violation du bail est inopposable au bailleur ».
Tandis que l’option envisagée prévoit que le bailleur peut exercer toute action née du contrat de sous-location contre le sous-locataire dans la limite des droits qu’il détient contre le locataire principal.
Réciproquement, l’option permet au sous-locataire d’exercer contre le bailleur toute action née du contrat de location, dans la double limite des obligations assumées par le bailleur en vertu du contrat et des droits que le sous-locataire tient du contrat de sous-location.
Ainsi, l’option permettrait tant au sous-locataire qu’au bailleur de se prévaloir de toutes actions et non pas uniquement d’une action directe en paiement à l’initiative du bailleur.
Enfin, un chapitre est dédié aux dispositions propres aux locations d’immeubles (articles 1749 et suivants du Code civil).
Ces dispositions permettent précisions sur le sort particulier des baux immobiliers.
Des dispositions portent le sort du bail d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité, notamment en cas de divorce, de dissolution du pacte et en cas de décès.
L’avant-projet de réforme des contrats spéciaux semble pertinent et nécessaire en ce qu’il permet d’insuffler modernité et clarté dans l’ensemble des dispositions.
Une société présidente de SAS peut obtenir réparation de son préjudice moral en cas de révocation brutale de ses fonctions. (Cass. com. 30-3-2022 n° 19-25.794)
Écrit par Léa Brunner
Crédit dessin: Michel Szlazak
Une société présidente de SAS peut obtenir des dommages-intérêts si sa révocation a été brutale. C’est ce qu’a confirmé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2022 (n°19-25.794).
Dans les faits, une SARL, représentée par son gérant, également associé unique, est Présidente d’une Société par Actions Simplifiées (SAS).
L’assemblée générale extraordinaire de cette société a décidé la révocation de la SARL de ses fonctions de Présidente dans des circonstances soudaines. La SARL conteste la régularité de sa révocation, estimant que cette dernière a été brutale et vexatoire et demande réparation de son préjudice moral.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 octobre 2019, reconnaît la déloyauté de la société eu égard aux circonstances brutales de la révocation. Ainsi, elle indemnise à ce titre en réparation du préjudice moral subi le seul gérant, personne physique, représentant la SARL mais non la SARL elle-même, considérant que cette dernière ne démontre pas l’existence d’un préjudice propre.
La SARL et son gérant se pourvoient en cassation. Ils font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SAS à payer au gérant la seule somme de 3 000 euros, alors « qu'une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit ».
Les juges de cassation ont dû se prononcer sur la question de savoir si la personne morale dirigeante d’un organe de la société pouvait obtenir réparation de son préjudice moral du fait de la brutalité de sa révocation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ; dès lors que la Cour d’appel avait constaté que la société n’avait pas respecté son obligation de loyauté et donc considéré que la révocation s’était faite dans des circonstances brutales et vexatoires, elle ne pouvait pas lui refuser l’octroi de dommages et intérêts en guise de réparation de son préjudice moral.
Ainsi, des dommages-intérêts auraient dû être attribués à la SARL en réparation de son préjudice moral.
Mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales : le décret d’application est paru !
Écrit par Léa Brunner Crédit dessin: Michel Szlazak
Crédit dessin: Michel Szlazak
Pour rappel, adoptée le 24 décembre 2021 et publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2021, la loi n° 2021-1774, communément appelée « Loi Rixain », vise à accélérer l’égalité économique et professionnelle en instaurant de nouvelles obligations pour les entreprises. Pris pour l’application de l’article 14 de cette loi, le décret n°2022-680 du 26 avril 2022 précise les modalités relatives à la répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Faisant suite, 10 ans après, à la loi dite « Copé-Zimmermann » instituant des quotas de femmes dans les conseils des sociétés cotées, la récente adoption de la loi Rixain poursuit et approfondit l’objectif de parité au sein des entreprises.
Cette loi comporte des mesures pour le quotidien des femmes et pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans les grandes écoles, dans les entreprises et dans l'entrepreneuriat.
Ainsi, la loi Rixain impose notamment aux entreprises qui emploient plus de 1000 salariés, sur 3 exercices consécutifs, de :
- Respecter une répartition équilibrée des hommes et des femmes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes. Pour cela, un quota de 30 % minimum de personnes de chaque sexe aux postes de direction sera applicable à compter du 1er mars 2026 (article L. 1142-11 du Code du travail), taux qui sera augmenté à 40 % au 1er mars 2029.
- Publier les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes aux postes de direction, sur le site Internet du ministère du Travail.
- Déterminer les mesures de correction à mettre en œuvre si la représentation des femmes n’est pas respectée, par le biais de la négociation obligatoire d’entreprise sur l’égalité professionnelle (article L. 1142-13 du Code du travail), ou, à défaut d’accord, sur décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique de l'entreprise.
- Mettre en conformité l’entreprise avec les obligations de représentation dans le délai de 2 ans (article L. 1142-12 du Code du travail), à peine de se voir infliger une pénalité financière correspondant à 1 % maximum des rémunérations et gains versés aux salariés et aux travailleurs assimilés pendant l'année précédant l'expiration du délai.
Pris pour application de l’article 14 de cette loi créant une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des grandes entreprises, le décret n°2022-680 du 26 avril 2022 vient apporter des précisions sur les modalités relatives à cette répartition équilibrée de chaque sexe.
A cette fin, 5 nouveaux articles sont ajoutés au Code du travail (articles D1142-15 à D1142-19).
Sont ainsi prévues :
- Les modalités de calcul et de publication, sur le site internet de l'entreprise et sur celui du ministère chargé du travail, des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés ;
- Les modalités de publication des objectifs de progression et des mesures de correction que l'entreprise doit publier à l'issue d'un délai d'un an à compter de la non-atteinte de l'objectif chiffré en matière de représentation entre les femmes et les hommes prévu au dernier alinéa de l'article L. 1142-11 du Code du travail.
- Une obligation de transmission de ces écarts éventuels de représentation, de ces objectifs et de ces mesures, ainsi que de leurs modalités de publication, aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique
- La précision selon laquelle les écarts éventuels de représentation sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, à défaut, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
(Toutefois, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article D1142-16, les entreprises peuvent publier jusqu’au 1er septembre 2022 ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au titre de l’année précédente.)
- Qu’est-ce qu’une instance dirigeante au sens de cette loi ?
La loi dispose qu’est « considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions » (nouvel article L23-12-1 du Code de commerce). Il s’agit de « viser, pour l’ensemble des formes sociales possibles pour les sociétés commerciales, les organes sociaux et autres instances chargés de contribuer au processus de décision concernant les problématiques de direction et de gestion les plus stratégiques pour une société ».
En pratique, sont par exemple concernés :
- Dans une société anonyme ou société en commandite par actions : le comité de direction ou comité exécutif ;
- Dans une société par actions simplifiée : l’instance mise en place, le cas échéant, afin d’assister le président de la société dans l’ensemble de ses fonctions de direction générale, quelle que soit sa dénomination (comité de direction, comité exécutif, comité stratégique, comité des directeurs, conseil de direction…).
En revanche, le ministère du travail a précisé dans le questions-réponses que certaines instances ne sont pas visées par le dispositif, notamment :
- Le directoire dans une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance ;
- Le conseil de surveillance et le conseil d’administration dans une société par actions ;
- Les organes collégiaux de direction des sociétés par actions simplifiées, auxquels les statuts confèrent un pouvoir de direction.
- Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant au sens de cette loi ?
Il convient de se référer à l’article L3111-2 du Code du travail afin de définir le cadre dirigeant.
Cet article pose trois critères cumulatifs pour être considéré comme cadre dirigeant :
- Les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
- Habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- Perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Le Tribunal de commerce est seul compétent pour connaitre d’une action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant de fait.
Écrit par Me Valentine Wirig
Crédit dessin: Michel Szlazak
Faut-il statuer préalablement sur le bien-fondé de l’action en responsabilité du dirigeant de fait pour déterminer dans un second temps la juridiction compétente ? C’est cette question qui a été tranchée par la négative par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 30 mars 2022 dans un arrêt n°20-11776.
Les faits étaient les suivants : Une holding détenue à parts égales entre d’une part une SARL et d’autre part les époux E détenait 100% des titres d’une SARL et une SAS, dont Monsieur E était le dirigeant de droit. Il bénéficiait en outre avec son épouse d’un contrat de travail au sein de la holding.
Le 18 mars 2015, Monsieur E était révoqué de ses mandats sociaux, et lui et son épouse étaient licenciés par la holding. Cette dernière saisissait alors le tribunal de commerce d’une action en responsabilité à l’encontre des époux E qu’elle qualifiait de dirigeants de fait. Les époux E ont alors soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’hommale. Celle-ci était rejetée aussi bien par le Tribunal de commerce que par la Cour d’appel. Ils saisissent alors la Cour de cassation.
Leur raisonnement est le suivant : afin de déterminer si le litige relève de la compétence des tribunaux de commerce, la Cour d’appel doit préalablement examiner le bien-fondé de l’action en responsabilité. Ainsi, elle aurait dû dans un premier temps examiner si les époux E étaient véritablement des dirigeants de fait conformément aux critères dégagés par la jurisprudence. Une fois ce travail effectué, elle pouvait alors statuer sur la compétence du Tribunal de commerce.
La Cour de cassation rejette logiquement cette argumentation. Elle rappelle que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leur dirigeants de fait. Or, déterminer si la personne remplit effectivement les critères requis relève du bien-fondé de l’action et non de la compétence de la juridiction saisie.
Affirmer le contraire reviendrait à distribuer une partie du contentieux relevant de l’action en responsabilité des dirigeants de fait au Tribunal de commerce et une autre partie à un autre tribunal. Mais surtout, cela obligerait la juridiction saisie à statuer dans un premier temps sur le fond du dossier avant de pouvoir statuer sur sa compétence, alors même que les règles de procédure civile forcent à adopter une raisonnement inverse.
Ainsi, si l’article L.721-3 du Code de commerce qui fixe la compétence du Tribunal de commerce ne vise pas directement les actions dirigées contre les dirigeants de fait, la Cour de cassation en 2009 avait déjà affirmé sa compétence de principe pour connaitre de telles actions, pourvu que les faits qui leur sont reprochés soient en lien direct avec la gestion de la société.
A noter que ce critère n’est pas repris par la Cour de cassation dans ce dernier arrêt. Il conviendra donc d’être prudent et d’attendre que la Cour de cassation précise sa jurisprudence quant au maintien de ce critère.
Le formalisme de l’acte de cautionnement a été modifié par l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Écrit par Laurène Astruc-Cohen
Crédit dessin: Michel Szlazak
Prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, l’ordonnance du 15 septembre 2021 a affiché comme objectif de simplifier le droit des sûretés et de renforcer son efficacité tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, ceux des débiteurs et des garants.
A ce titre, l’ordonnance insère les règles relatives au cautionnement dans le Code civil afin de rétablir un droit commun uniforme en la matière. Il est donc possible de retrouver certaines dispositions du Code de la consommation désormais abrogées au sein du Code civil.
Le cautionnement faisait, sous l’empire du droit ancien, l’objet d’un strict encadrement tant par le Code civil que par le Code de la consommation donnant lieu à un abondant contentieux en la matière.
En effet, afin de garantir sa validité, le cautionnement devait contenir des mentions particulières écrites de la main de la caution et conformes à des modèles légaux impératifs.
En cas de discordance même minimes avec celui-ci, le cautionnement pouvait être déclaré nul.
Désormais et depuis le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme, le formalisme du cautionnement a été modifié et simplifié.
L’exigence de mention concernera la caution personne physique à l’égard de tous les créanciers (qu’ils soient professionnels ou non).
Conformément à l’article 2297 du Code civil, la caution devra indiquer dans l’acte de cautionnement, « à peine de nullité qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffre. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions ».
Le nouvel article 2297 du Code civil ne fait plus allusion à une mention manuscrite mais à une mention apposée par la caution elle-même afin d’intégrer l’éventualité d’un cautionnement par voie électronique.
Par ailleurs, contrairement à l’ancien régime, le montant de l’engagement de la caution devra être indiqué en chiffres et en lettres.
Enfin, la durée de l’engagement ne devra pas nécessairement être indiquée, mettant fin à tout débat jurisprudentiel présent sous l’empire de l’ancien régime.
Cette souplesse acquise par le biais de l’ordonnance du 15 septembre 2021 permettra sans nul doute aux juges d’apprécier la réalité de l’engagement d’une caution en s’éloignant de considérations presque exclusivement formalistes comme il était d’usage auparavant.
Plus...
Un contrat conclu « par une société » avant son immatriculation est nul : de l’importance des mots.
Écrit par Valentine Wirig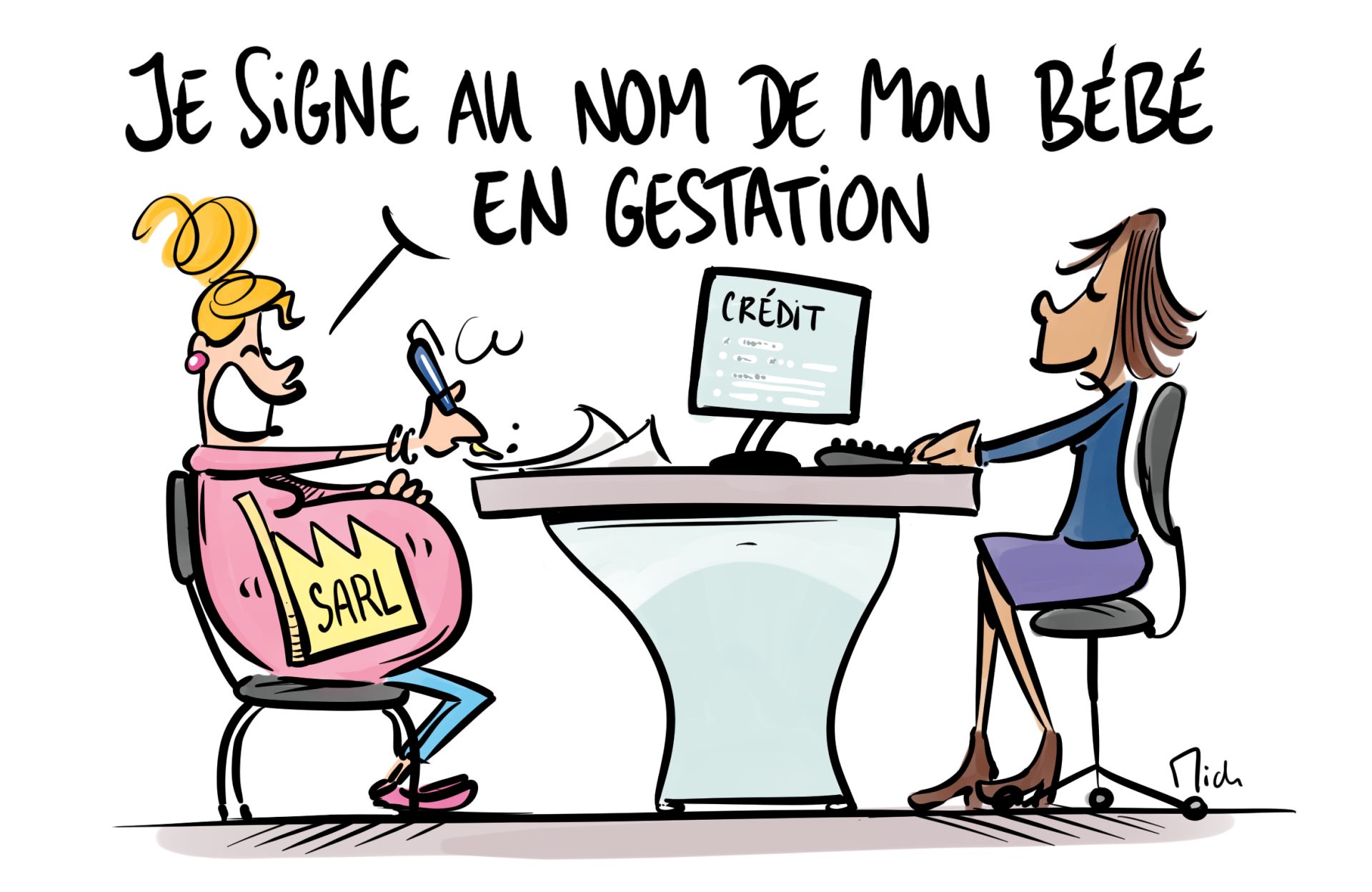
Crédit dessin: Michel Szlazak
La Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme une solution déjà connue des praticiens : un contrat conclu par une société avant son immatriculation est nul.
Dans l’espèce objet de l’arrêt du 19 janvier 2022, n°20-13.719, une banque avait consenti un prêt à « l’EURL, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par Mme Y ». La gérante et son époux s’étaient portés cautions solidaires du remboursement du prêt.
Puis, par un avenant au contrat de prêt postérieur à l’immatriculation de la société, cette dernière avait consenti à la banque un nantissement sur son fonds de commerce.
La société connaissant des difficultés, la banque a décidé d’actionner le cautionnement de l’époux.
La Cour d’appel a d’abord condamné l’époux au paiement en considérant que l’épouse avait valablement agi au nom et pour le compte de la société en formation, et que l’avenant signé par la société postérieurement à son immatriculation emportait reprise de l’engagement à son égard.
La Cour de cassation, sans surprise, censure la décision et rappelle que :
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de prêt du 20 décembre 2012 avait été conclu, non pas au nom et pour le compte d’une société en cours de formation mais par la société elle-même, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu’il était nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique, et que l’avenant à ce contrat, qui, selon ses propres termes, n’emportait pas novation, n’était pas de nature à couvrir cette nullité absolue, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.».
Elle réaffirme ainsi une solution déjà connue et confirme que la nullité encourue est absolue.
Ainsi, la simple mention de « société en cours d’immatriculation » n’est pas suffisante pour permettre à la société une reprise des engagements. Seule la mention « agissant au nom et pour le compte de la société en formation » permet à la société d’être engagée et assure la validité du contrat.
Les mots sont donc d’une importance cruciale pour la validité du contrat conclu avec une société mais avant son immatriculation.
En outre, la conclusion d’un avenant postérieur à l’immatriculation de la société est insuffisante pour couvrir la nullité, et n’emporte donc pas engagement de la société pour le contrat conclu avant son immatriculation.
Cet arrêt envisage une hypothèse qui n’avait pas encore été présentée à la Cour de cassation. Pour mémoire, elle avait déjà jugé que la nullité ne pouvait être couverte par une confirmation de l’acte litigieux ou par une ratification, ou encore par une assemblée. Désormais, il est acquis que la nullité n’est pas non plus couverte par la signature d’un avenant postérieur à l’immatriculation de la société.
Cette solution n’est cependant guère surprenante puisque la Cour de cassation ces deux dernières années réaffirme régulièrement sa position stricte et fait le choix de la publication de ses arrêts au bulletin sur ce point (pour le dernier arrêt : Cour de cassation,10 février 2021, n°19-10.006).
Les salariés lanceurs d’alerte protégés par la liberté d’expression.
Écrit par Laurène Astruc-Cohen
Crédit dessin: Michel Szalzak
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 19 janvier 2022 une décision publiée au bulletin dans laquelle elle décide qu’ « en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est atteint de nullité ».
Dans cet arrêt dont les faits datent de 2011, le salarié d’une société d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes avait alerté son employeur sur une situation de conflit d’intérêts concernant la société entre ses missions d’expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, situation prohibée par le Code de déontologie de la profession, en soulignant qu’il n’hésiterait pas à saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes s’il ne parvenait pas à discuter de cette question avec son employeur.
En l’absence de toute réaction de son employeur, ledit salarié a saisi la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Quatre jours après la saisine de l’organisme, le salarié était licencié pour faute grave.
Contestant fermement ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire constater le caractère nul ou sans cause réelle et sérieuse de celui-ci.
La Cour d’appel de Paris saisie du litige avait décidé que le licenciement était nul pour violation d’une liberté fondamentale et avait condamné en conséquence l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaire de mise à pied et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement nul.
La Cour d’appel a notamment reproché à l’employeur le contenu de la lettre de licenciement faisant mention expresse des menaces par le salarié de saisine de la compagnie régionale des commissaires aux comptes et de mise en œuvre concomitante de la procédure de licenciement avec l’alerte.
Pour retenir la nullité du licenciement et approuver la décision de la Cour d’appel, la Cour de cassation se fonde sur la liberté d’expression et le droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail.
La Cour de cassation ainsi que la Cour d’appel viennent une nouvelle fois protéger les salariés lanceurs d’alerte face à la dénonciation de situations pouvant caractériser des manquements à des obligations qui cette fois-ci sont déontologiques.
En rendant cette décision, la Cour a implicitement mis en lumière nombre de principes qui animent la protection des salariés et qui étaient inapplicables en l’espèce au vu de l’antériorité des faits.
En effet, les dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de l’article L1132-3-3 du Code de travail protégeant les lanceurs d’alerte n’étaient pas encore en vigueur au moment des faits.
De la même manière, l’article L1235-3-1 du Code du travail permettant de solliciter la nullité d’un licenciement en raison de la violation d’une liberté fondamentale est issu de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et n’est entré en vigueur qu’à compter du 1er avril 2018.
La volonté d’une jurisprudence homogène au sujet des lanceurs d’alerte semble dès lors évidente.
Cession de titres sociaux : du nouveau sur la garantie d’éviction du cédant.
Écrit par Céline Humbert
Crédit dessin: Michel Szlazak
L’interdiction de rétablissement sur le fondement de la garantie d’éviction est désormais limitée dans le temps (Cass. Com. 10 novembre 2021, n° 21-11975).
Si vous vendez votre entreprise, vous devez assurer la possession paisible de cette société à votre acheteur : c’est la définition, simplifiée, de la garantie d’éviction. Elle implique notamment l’interdiction pour le vendeur de se rétablir après la vente et de capter ainsi à nouveau la clientèle vendue.
Cette garantie est, en matière de cession de titres sociaux, assez rarement actionnée car les cessions sont généralement encadrées par des clauses de non-concurrence qui encadrent plus efficacement les détournements de clientèle.
Elle reste néanmoins un recours utile en l’absence de clause de non-concurrence ou lorsque le délai fixé par la clause est dépassé.
Mais dans ce cas, la jurisprudence impose, pour conclure à une interdiction de rétablissement, que « ce rétablissement soit de nature à empêcher les acquéreurs [des actions cédées] de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social » (Cass. Com., 21 janvier 1997, n°94-15207).
Or, la Cour de cassation vient d’ajouter un autre critère à une demande tendant à l’interdiction de rétablissement sur le fondement de la garantie d’éviction : il faut désormais que l’interdiction de rétablissement soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, et donc qu’elle soit limitée dans le temps. Les juges sont donc désormais invités à rechercher si l’interdiction de se rétablir se justifiait « encore » au moment des faits reprochés (Cass. Com. 10 novembre 2021, n° 21-11975).
Les faits de l’espèce semblaient pourtant édifiants : les vendeurs ne contestaient pas avoir rouvert une activité concurrente, récupéré 8% de la clientèle de la société cédée, débauché environ 20% des salariés... oui mais 3 ans après la cession pour le premier vendeur et 4 ans après pour le deuxième. Les magistrats qui se repencheront sur cette affaire devront donc apprécier in concreto si cette durée était suffisante, et si une interdiction de rétablissement si longue ne violerait pas, finalement, la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre.
Par un avis du 1er décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché une question longuement débattue par la doctrine : L’usufruitier est-il associé ?
Écrit par Me Valentine Wirig
Dessin: Michel Szlazak
Par cet avis, elle y répond de manière ferme puisqu’elle énonce que « L’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaitre la qualité d’associé » mettant ainsi fin au doute qui subsistait sur le statut de l’usufruitier.
En effet, la Cour jusqu’à présent avait gardé le silence sur le statut lui-même de l’usufruitier. Les décisions rendues concernaient pour l’essentiel les droits de celui-ci dans le partage des bénéfices.
La Cour rend son avis au visa de l’article 578 du Code civil qui dispose que :
« L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à charge d’en conserver la substance ».
Elle en déduit que l’usufruitier n’est pas le propriétaire des parts sociales, puisque cette qualité appartient au nu-propriétaire. Dès lors, et en toute logique, seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé. En revanche, l’usufruitier jouit de la qualité d’associé « comme le propriétaire lui-même ». Il bénéficie ainsi des droits attachés à cette qualité.
La chambre commerciale en tire les conséquences suivantes : « L’usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérant, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. ».
Elle affirme ainsi que l’usufruitier est amené à intervenir dans la vie de la société en dehors de la distribution de dividende, mais pour ne pas léser le nu-propriétaire elle pose deux limites :
-La délibération doit avoir une incidence sur le droit de jouissance des parts sociales ;
-L’incidence doit être directe.
S’agissant du premier critère, celui-ci est semble-t-il entendu largement puisque la Cour considère que la délibération doit être « susceptible » d’avoir une incidence sur le droit de jouissance de l’usufruitier. Il n’est donc pas nécessaire de prouver que la délibération a une incidence certaine mais simplement de démontrer qu’elle pourrait en avoir une. En revanche, le second critère semble être entendu plus strictement puisque la Cour précise que l’incidence doit être directe.
Pour autant, aucune définition ou précision n’est donnée sur la manière dont sera appréciée l’incidence directe.
Pour avoir plus de précision, il faudra donc attendre la décision de la troisième chambre civile qui avait sollicité cet avis. En l’espèce, provoquer une délibération des associés en vue de la révocation du gérant et la nomination de cogérant nous semble assez éloignée de toute idée « d’incidence directe sur la jouissance des parts sociales de l’usufruitier ». Reste à voir ce que la troisième chambre civile en conclura au vu de la situation qui lui est soumise. La suite au prochain épisode !



